Tristan Bernard (1866-1947) dans le domaine public
Les œuvres de Tristan Bernard, écrivain resté célèbre pour son esprit subtil et son humour, sont entrées dans le domaine public le 1er janvier dernier. Elles ont commencé à être numérisées pour être consultables dans Gallica, occasion de mieux connaître cette personnalité aux multiples facettes.
Si Tristan Bernard est resté dans les mémoires pour ses comédies et ses aphorismes, on découvre en effet que ceux-ci furent nourris par une vie bien remplie d’expériences très variées, une vie d’homme du monde de la Belle époque aux Années folles, deux périodes qu’il radiographie au prisme de son caractère facétieux, attachant et optimiste. Ses amis, avec lesquels il rivalise de mots d’esprit, d’humour et de créativité, s’appellent Alphonse Allais, Jules Renard, Lucien Guitry, Alfred Capus, Sarah Bernhardt ou Toulouse-Lautrec.
« Je suis un contemplateur fervent de l’effort d’autrui »
Au début de sa vie, Paul Bernard (son prénom d’état civil) expérimenta des métiers bien loin de la littérature. Licencié en droit, cet avocat ne plaidera qu’une seule fois, ne se sentant pas l’âme d’un justicier. Il dispense alors des conseils juridiques dans un cabinet pour subvenir aux besoins de son ménage. Son père et son oncle, à la tête d’une usine d’aluminium, lui propose ensuite d’y entrer comme administrateur. Peu doué pour ce poste, il démissionne finalement.
Entre temps, il avait beaucoup fréquenté, par goût, les milieux sportifs. Issu d’une famille provinciale de maîtres de poste, il gardera toute sa vie une affinité particulière pour les chevaux et les courses, qu’il fréquentera entre Paris, où s’installe sa famille dès 1878 (il a 13 ans et restera parisien toute sa vie) et ses villégiatures, Nice et Deauville. C’est d’ailleurs à un cheval, nommé Tristan, sur lequel il avait parié et qui remporta une course, qu’il doit son pseudonyme, adopté dès 1891.
Il sait manier le fleuret, comme tout jeune homme éduqué de l’époque, mais répugne aux duels, peu en phase avec son caractère égal, et qu’il trouve ridicules. Il ne manque pas de moquer les affaires d’honneur dans plusieurs de ses pièces, comme Les deux canards. Il pratique un peu la boxe. Il sera même arbitre d’un match comme le montre cette caricature :
L’ouvrage de Fernand Cuny, La boxe, lui doit son introduction. Autour du ring : tableau de la boxe regroupe plusieurs de ses textes sur ce sport, à propos duquel il écrit même un roman Nicolas Bergère, joies et déconvenues d'un jeune boxeur.
Tristan Bernard se prend de passion pour le vélo, nouvelle coqueluche du siècle, qu’il a très vite adopté. Il se fait rapidement une solide réputation dans le milieu du cycle. C’est ainsi qu’il se voit confier en 1892 la direction du flambant neuf vélodrome Buffalo, à Neuilly, premier emploi dans lequel il se sent à sa place, et qu’il honorera pendant 4 ans. Il fonde dans la foulée le Journal des vélocipédistes.
Délaissant la pratique, Tristan Bernard se fait un nom comme expert et journaliste sportif. Il publie dans plusieurs journaux et revues, notamment La Revue blanche, par exemple cet article co-signé avec Léon Blum, donne des conférences, participe à des congrès. Il se verra même invité à faire partie du comité d’organisation des Jeux Olympiques de 1924, ce qu’il déclinera.
Jusqu’avant la guerre, alors qu’il a renoncé à écrire pour le théâtre, il restera ce grand amateur éclairé : il accompagne le Tour de France de 1934, dont il tient une chronique radiophonique quotidienne.
« Au théâtre les spectateurs veulent être surpris. Mais avec ce qu'ils attendent. »
Grand observateur de son époque et de la nature humaine, Tristan Bernard trouve dans la comédie une expression vivante de son regard acéré, mais bienveillant. Sa première pièce, Les pieds nickelés, créée en 1895, le propulse sur le devant de la scène. Les succès s’enchaîneront. Il a une prédilection pour les pièces en un acte, où s’épanouit son humour incisif : plusieurs ont été rassemblées dans Théâtre sans directeur. Certaines de ses pièces sont un miroir de son époque, comme L’accord parfait et Le Poulailler, dont l'intrigue est fondée sur le ménage à trois, situation courante et tolérée à la Belle époque.
Il écrira environ 70 pièces, dont un opéra bouffe, La petite femme de Loth, mis en musique par Claude Terrasse, une tragi-comédie, L’Etrangleuse, ainsi que des sketchs pour la radio. En effet, particulièrement attentif à la réception de ses œuvres, il ne se contente pas de la diffusion des spectacles enregistrés, mais adapte son écriture au mode de diffusion. Ses pièces sont servies par les plus grands comédiens de son temps, en particulier son amie Sarah Bernhardt, ci-dessus dans Jeanne Doré.
En 1930, les propriétaires du théâtre Albert 1er lui offre la co-direction de cette salle, qui va prendre son nom. Projet qu’il caressait depuis longtemps comme nombre de ses confrères.
Mais l'expérience ne dure pas plus d'une saison car la salle, excentrée par rapport au Boulevard, difficile d'accès, et souffrant d'une mauvaise réputation dans le milieu théâtral, ne fait pas recette. Et Tristan de conclure cette aventure par ce mot : « Ce n'était pas le théâtre Tristan Bernard, mais le théâtre Sahara Bernhardt ». Suite à cette vive déception, il n’écrira plus pour le théâtre.
« Un écrivain ne doit pas chercher à être incohérent et anormal, souvent il l'est déjà suffisamment sans s'en douter. »
Cet esprit toujours bouillonnant a plus d'une corde à son arc. C'est un recueil de nouvelles qu'en 1894 il publie en collaboration avec son beau-frère Pierre Veber, Vous m’en direz tant ! Il s'essaie au roman dès 1899 avec Mémoires d'un jeune homme rangé, et en publiera jusqu’en 1935, dont Le Roman d’un mois d’été en 1909, Robins des bois, pour lequel il s’est sans doute souvenu avec malice du milieu judiciaire de ses débuts . Il donnera plusieurs titres au genre policier : entre autres L’affaire Larcier en 1907, Mathilde et ses mitaines en 1912, Aux abois : journal d’un meurtrier, roman au style avant-gardiste publié en 1933.
On lui doit aussi d'avoir été dès 1924 l'un des diffuseurs et promoteurs des mots croisés, jeu né aux Etats-Unis en 1913, en France. Il approfondi l'exercice en thématisant ses grilles et en s'éloignant des définitions littérales pour les transformer en jeux de mots, calembours et casse-têtes humoristiques, en faisant un sport ... cérébral.
Grand humoriste de son temps, Tristan Bernard a donné libre-cours à sa fantaisie dans de nombreux journaux, comme dans le Canard enchaîné où paraît Le Lion, en 1918, court texte d’humour noir, enregistré par Jean-Marc Tennberg en 1959. Il fait paraître dans la Revue blanche, pendant 13 numéros, un supplément humoristique intitulé Le Chasseur de chevelures, moniteur du possible dont il est seul rédacteur. Selon les numéros, il se présente comme « Informateur du possible », ou « Rédacteur intègre ». Et Pierre Veber, chargé de la mise en page, est « Déformateur du réel », ou « Rédacteur vénal (2 frs la ligne) ». Il y fait même paraître des pièces, comme Les Vénitiens de Paris.
Tristan Bernard voit également la naissance du cinéma. Pressentant l'avenir de ce nouveau média, il confie à son fils Raymond, réalisateur, l'adaptation muette du Petit café, de Triplepatte et du Costaud des Epinettes, trois de ses pièces à succès. Le jeune cinéma parlant, apparu en 1927, lui donne l'occasion d'exercer ses talents comme dialoguiste, et de voir ses pièces continuer d'être adaptées à l'écran.
« Le costume d'académicien coûte cher, trop cher, j'attends qu'il en meure un qui ait ma taille. »
Reconnu de son temps comme une grande figure du monde intellectuel, Tristan Bernard est fait chevalier de la légion d’honneur en janvier 1903, ainsi que s’en font l’écho plusieurs organes de presse, comme le Petit Parisien et Le Monde artiste. En 1927, il se plie par deux fois au jeu de la candidature à l’Académie, bien qu’il tourne l’institution en dérision, mais motivé la seconde fois par le fauteuil laissé vacant par l’auteur de comédies Robert de Flers. Mais il ne sera jamais reçu comme académicien français, « le commun des immortels » (Mots croisés, Cinquantes problèmes, 1925). Il s’en console, comme à son habitude, par un trait d’esprit : « J'aime mieux être de ces écrivains dont on se demande pourquoi ils ne sont pas de l'académie, qu'un de ceux dont on se demande pourquoi ils en sont ».
On l’imagine pouffer dans sa barbe à se voir cité dans l’édition de 1928 de Romans à lire et romans à proscrire. Essai de classification au point de vue moral des principaux romans et romanciers (1500-1928), comme auteur de « romans lestes, inconvenants ou cyniques » … Il s’associe à Toulouse-Lautrec pour publier un petit supplément humoristique à la Revue blanche de janvier 1895, intitulé NIB, qui vient bien étrangement (ou bien opportunément …) prendre place au beau milieu d’une traduction du pamphlet misogyne de Strindberg « De l’infériorité de la femme – et comme corollaire de la justification de sa situation subordonnée selon les données dernières de la science » (1890) suggérant ainsi combien il se gausse des censeurs de toute époque …
« Vous allez voir qu'un jour, on va nous déclarer la paix et que nous ne serons pas prêts. »
C'est avec cet humour persistant, parfois noir, que Tristan Bernard traverse les deux conflits mondiaux. Dès 1904 il rédige des articles pour l'Humanité, le journal socialiste de Jean Jaurès. Il y livre à l’occasion sa vision ironique de la société et de la politique à travers de courts articles, comme « Fléaux sur mesure », ou « Cours du soir pour les Apaches », qui traduisent sa haine de la guerre.
Il n'est pas mobilisable en 1914, néanmoins, ses fils ayant revêtu l’uniforme, il souhaite s'engager d'une façon ou d'une autre. Mais il ne parvient pas à se faire engager au Grand Quartier Général. C'est par sa plume qu'il va alors participer à l'effort de guerre. Il produit comédies, sketchs et pochades pour distraire les civils et les permissionnaires. Il crée également une revue destinée à soutenir le moral de l'arrière, Le Poil civil, « organe à peu près » puis « définitivement hebdomadaire des réserves de l'armée inactive », et enfin « organe hebdomadaire de quelques immobilisés plus ou moins chevelus », dont il est « Rédacteur en chef, leader, chef des échos, critique militaire, et gérant ».
La seconde guerre, qu'il tente de dédramatiser par ses bons mots jusqu’au dernier moment (« En 1914 on disait On les aura, et bien maintenant, on les a » ; « Tous les comptes sont bloqués, tous les Bloch sont comptés ») fut toutefois marquée par les brimades des lois raciales, subies en tant que juif dès 1942 (annulation de conférences, etc.) et par la mort en déportation d'un de ses petits-fils. Il sera lui-même déporté quelques jours avec sa femme au camp de transit de Drancy, d'où il sera libéré grâce à l'intervention de ses relations. Cependant, ce court séjour dans l'enfer nazi, la perte de ses biens dont sa bibliothèque, spoliée et en partie seulement restituée, et le deuil le laissent fatigué et désabusé. Il s'éteint en décembre 1947.
Pour aller plus loin
Biographie : Tristan Bernard ou le temps de vivre
Sur Tristan Bernard et le sport : Le marquis des stades


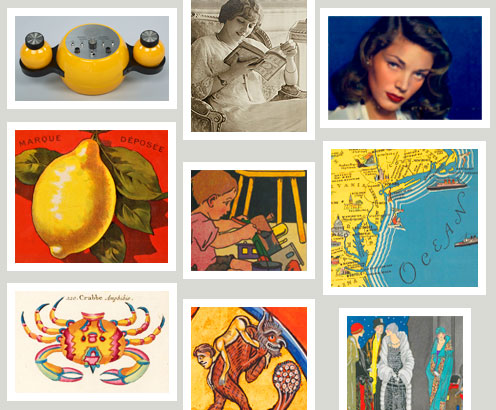






Commentaires
une biographie de Tristan Bernard
Je me reconnais dans le Tristan Bernard des deux guerres et me dit que ce n'est sans doute pas la bonne attitude mais qu'elle en atténue l'horreur, merci de cette courte mais accessible bibliographie.
Ajouter un commentaire