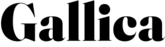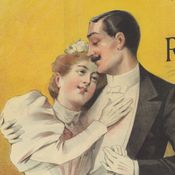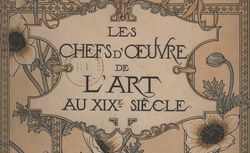• Le Rayon vert de Jules Verne
Une grande partie de l’exploration de l’Écosse à la recherche du rayon vert se fait par bateau dans le roman. Verne prend le temps de décrire les différentes embarcations, en insistant sur leur modernité, comme c’est le cas par exemple au début du chapitre IV avec la description du steamer Columbia : « En ce moment […] et en bon air. »
• De la Terre à la lune trajet direct en 97 heures 20 minutes de Jules Verne
Le roman se fonde sur la possibilité de prouesses technologiques sans cesse plus impressionnantes. Le peuple, d’ailleurs, apparaît dans le roman fasciné par le projet de lancement d'un projectile sur la Lune, et en suit toutes les étapes. Au chapitre II le projet d’utiliser la balistique pour aller sur la Lune en envoyant un boulet est présenté, et le projet enthousiasme les foules : « - J’en ai fini […] cette petite expérience. »
Le roman présente les différents problèmes scientifiques posés par la mise en œuvre du projet. Le chapitre V entier s'intéresse à la Lune, ce que l’on en sait, l’évolution du savoir depuis le mythologique jusqu’au scientifique. Ici par exemple le sujet est ce que l’on sait de la Lune et ce que l’on souhaite en découvrir : « Enfin […] politiques et moraux. »
Plus loin, quand la construction des éléments nécessaires commence, on découvre au chapitre XV que l’homme, par la technologie, devient créateur : « Quelques minutes avant midi […] de métal en fusion. »
• Une ville flottante de Jules Verne
Une ville flottante se déroule sur le Great Eastern, paquebot à roue à aubes qui fut une prouesse technologique – mais dont nombre d’aspects se révélèrent problématiques. Au chapitre I, une description du navire est prise en charge par le narrateur ; et plus précisément dans le cas de cet extrait, une description des roues à aube : « Cependant les ouvriers […] du steam-ship. »
Plus loin, et comme souvent, le narrateur insiste sur l’aspect exceptionnel du navire. Dans le cas de cet extrait du chapitre VII il se concentre sur les machines : « Les machines du […] supposé « Great Eastern » ». On trouve à nouveau une description du navire au chapitre XVIII : « Le lendemain […] par les coups de tangage. »
Mais Jules Verne n’est pas le seul à présenter la modernité et le progrès. On en trouve également des éléments chez d’autres auteurs :
• Au Bonheur des Dames d’Émile Zola
Dans le roman, la modernité est incarnée par le grand magasin, par opposition aux plus petites boutiques, plus anciennes, correspondant à d’anciennes pratiques de vente. Il s'agit là d'un progrès social et économique. Dès le chapitre I, la fascination de cette nouveauté s’exerce sur la jeune Denise : « Alors, Denise eut la sensation […] de la vente d’en face. »
La tentative de Robineau pour faire concurrence à Mouret passe par des innovations, des éléments de modernité ajoutés à sa boutique au chapitre VII : « Ce fut à ce moment que […] sans espoir de les vendre. » Dès l’abord, ces tentatives de modernisation sont insuffisantes, écrasées par le progrès constant du Bonheur des Dames.
• La 628-E8 d'Octave Mirbeau
Ces quelques textes se penchent sur l’expérience du voyage en voiture, qui constitue une relative nouveauté et un véritable progrès technique. Dans cet extrait de la troisième publication, le narrateur s’exprime sur la quasi-folie que provoque ce type de voyage : « Il faut bien le dire […] comme le rêve. »
Plus loin, dans la cinquième publication, le narrateur se lance dans une conversation sur les différentes voitures : « Pour répondre […] pleines et rondes. »