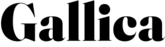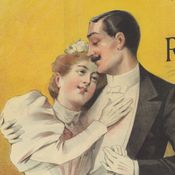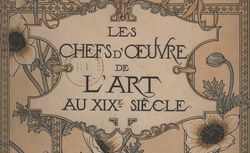• Une histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly
Agathe, la servante a un rapport superstitieux au personnage du prêtre, comme on le constate dans cet extrait du chapitre IV qui se poursuit dans le numéro suivant : « Si au lieu d’être Normande […] de jour en jour plus pâle… » Au chapitre V, ce lien qui peut exister entre religion et superstition est en quelques sorte mis à l’étude : « Elle n’était pas superstitieuse […] la plus redoutable ! » Il y a ici une mise à distance. C’est le regard d’une femme éduquée sur la superstition mis en opposition avec le regard de la servante qui croit aux légendes et aux signes.
Enfin, un véritable épisode de croyance populaire en action a lieu au chapitre IX. Agathe trouve un cercueil en travers de la route, associé pour elle à de mauvais présages : « Tout à coup, dans ces chemins […] entre ses deux haies. »
• Jeanne de George Sand
Dans la campagne reculée où se déroule le roman, les personnages sont certes chrétiens, mais leur catholicisme est mâtiné d’un certain paganisme aux airs un peu gaulois – lequel rend d’autant plus opérante la comparaison de Jeanne avec Velléda dans le prologue. On rencontre ainsi des fades, figures de fées, mais également des légendes transmises de génération en génération.
Au chapitre V le curé explique au jeune Guillaume certaines superstitions de la région : « Attendez, monsieur […] romans et roman ! » On a ici affaire au regard extérieur d’un homme d’église et éduqué, sur des pratiques paysannes et de l’ordre du folklore. Plus loin, au chapitre XXI, un paragraphe montre Jeanne et ses croyances, associées notamment à Jeanne d’Arc : « Et quand l’écho des rochers […] enfants comme lui. »
• La Petite Fadette de George Sand
La mère Fadet est présentée dès le départ comme un personnage trouble, dans la perception des autres, au croisement entre la guérisseuse et la sorcière. On le constate dans cet extrait du chapitre VI : « Enfin l’idée lui vint […] le chagrin ne donne pas beaucoup de raisonnement. » Plus tard, dans le cas de Fanchon, on voit l'association qui se fait, dans l'esprit des gens et ici de Landry, entre l’amour pour cette fille, incompréhensible, et sa capacité à ensorceler. C'est le cas dans le deuxième volume, au chapitre II : « Le lendemain […] de faire connaître. »
• Joseph Balsamo d’Alexandre Dumas
Le personnage de Joseph Balsamo a un pouvoir qui subjugue, notamment les femmes, et qui a quelque chose de presque surnaturel. On le voit en action pour la première fois au chapitre VI : « Je ne nie pas que vous ayez […] cent cinquante ans dit Balsamo. » Ce pouvoir s’explique en réalité par la science occulte du magnétisme, dont l'action est explicitée par Balsamo au chapitre IX : « Et la jeune fille […] Elle marcha. »
Dans d’autres cas, ces superstitions s’ancrent dans des prédictions (souvent faites par des bohémiens ou d’autres personnages marginalisés) ou des contrats :
• Le Capitaine Fantôme de Paul Féval
La vengeance de Pharès trouve sa source dans un univers bohémien et gitan, habité de superstitions et de prédictions aux apparences magiques. On découvre cette lecture de l'avenir au chapitre VII de la première partie : « En suivant le doigts […] gênait la gaieté. » Ici, la superstition est plus forte que la foi ou la logique, car le personnage ne parvient pas à ne pas prendre au sérieux ce qu'annonce cette lecture des signes.
Cependant, dans la deuxième partie, apparaît l'idée que le cœur des superstitions se trouve chez ceux qui en profitent, les Roms. Au chapitre V, on voit cette croyance forte au sein même de ce peuple : « Il est connu que tous les gens […] dans l’eau froide. »
Par ailleurs, un personnage en particulier, surnommé Noir-Cormin, est affligé de crises profondes de l'âme. La déprime ou la maladie de l’âme sont exprimées en termes mystiques, par des éléments proches de la vision et raccrochés à la littérature, dans le cadre de l’Écosse et de ses fortes superstitions. On le voit au chapitre XIII de la première partie : « De graves esprits […] parce qu’elles sont folles. »
• Un prêtre marié de Barbey d’Aurevilly
En parallèle de la foi, la superstition a une large place dans le destin du personnage principal. Au chapitre IV (II en volume) ont lieu des prévisions de l’avenir, qui se vérifient dans le roman : « Or, un jour […] coupe une asperge. » Si cartésien que soit l’ancien prêtre, il est sensible à ces prévisions. Il pose néanmoins un regard critique, celui de l’homme de science, sur sa propre croyance superstitieuse, comme ici au chapitre XIII (VIII en volume) : « Tu me regardais donc […] de ma faiblesse. »
• Partie carrée de Théophile Gautier
Les faits mystérieux qui se déroulent trouvent leur origine dans un serment, qui interdit au jeune homme de se marier et qui amène la destruction du nouveau ménage. Cela est explicité dans cette lettre au chapitre X : « Pendant qu’il sommeillait […] Signé de mon sang, Valmerange. » Au chapitre XIII, une scène renvoie au mystique voire à une forme de sorcellerie : « Elle ouvrit différentes […] vous rompriez le charme. »