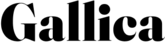La catastrophe peut-elle être comique ? (1/2)
Bien des mots de notre langue nous réservent des surprises lorsque nous nous tournons vers leurs significations d'autrefois. Ainsi, en va-t-il du terme catastrophe dans la dramaturgie, qu'il s'agisse de tragédie ou de... comédie.
La catastrophe comme dénouement théâtral
Dans les sociétés modernes sécularisées, l’apocalypse n’est jamais que la forme suprême de la catastrophe. Elle est la catastrophe qui fait advenir la fin du monde. Et, de même que le terme ‘apocalypse’ est ambivalent puisqu'il eût le sens, pour les chrétiens de l'Antiquité, de révélation divine, 'catastrophe’ n'a pas toujours eu la signification négative qu'il a acquise pour nous. Emile Littré, dans son célèbre Dictionnaire de la langue française (1873-1874) indique deux sens pour ce mot. Le premier est celui avec lequel nous sommes aujourd’hui familiers ; le deuxième est le sens qu’il a pris, pendant plusieurs siècles, en dramaturgie.

"... car la fin et catastrophe de la comédie approche "
Aussi, un lecteur contemporain ne manquera-t-il pas d'être surpris en tombant sur un passage du Quart livre de Rabelais, publié en 1552, où Pantagruel explique l'importance qu'il y a, en se fondant sur des signes lisibles dans les astres, à anticiper le trépas d'un homme. Ainsi, fait-il valoir, on pourra, non pas tant recueillir à temps les dernières volontés du mourant, que bénéficier de ses recommandations pour la suite.

Ce que Rabelais, dans le langage savoureux qui est le sien, énonce en ces termes : "Ainsi, par telles comètes, comme par une flamboyante écriture cosmique, les cieux nous disent tacitement: hommes mortels, si vous voulez savoir, apprendre, entendre, connaître, prévoir quelque chose sur ces âmes bienheureuses, que ce soit pour le bien et l'utilité publique ou privée, prenez la précaution de vous présenter à elles et d'en obtenir des responses, car la fin et la catastrophe de la comédie approchent. Une fois celle-ci terminée, c'est en vain que vous les rappellerez."
Cette association de la catastrophe et de la comédie n’est pas une fantaisie de Rabelais. En son temps, le terme désignait, en effet, l’issue en général d’une pièce de théâtre. C’était le dénouement qui conduisait à sa fin. Elle pouvait être heureuse comme funeste. Au théâtre, la catastrophe n’était donc pas nécessairement à l’image de ce décor de scène romantique peint pour une représentation du Crépuscule des Dieux de Richard Wagner :

L'on pouvait aussi bien parler de la catastrophe d'une comédie,
" Les comédies ont presque toujours des catastrophes heureuses."
Les principales occurrences au XVIe siècle de ‘catastrophe’ confirment l’usage rabelaisien. C’est le cas, par exemple, de la traduction française des nouvelles de l’italien Matteo Bandello, improprement traduites « Histoires tragiques » . Dans l’un de ses plus célèbres récits, l’auteur met en scène deux amants, Aleran et Adélasie, qui pour échapper au père de la jeune femme, l’Empereur Otton, se déguisent : « …craignant d’estre surprins commencèrent à jouër la comédie, les actes de laquelle furent assez longs, et le rollet [rouleau] de leur misère trop prolixe, et facheuz à supporter, avant que venir à la catastrophe, et fin de l’action comique. »
L’entrée « Catastrophe » d'un Grand dictionnaire historique publié en 1683 reflète cet usage commun:

Ce n’est que progressivement que ‘catastrophe’ en vient à prendre un sens exclusivement négatif et ne plus désigner que l’issue funeste d’une histoire. Dans le même temps, le terme passe du champ du théâtre et, plus largement, des récits, à celui de de la réalité effective. Il en vient, par extension, à signifier un événement tragique, un bouleversement violent qui produit un grand malheur. C’est ce dont témoigne, parmi bien d’autre exemples, ce passage de l’Inventaire général de l’histoire de France depuis Pharamond jusqu’à présent (1600) de Jean de Serres: "Mais ainsi se joue la journalière vicissitude des choses humaines, pour faire par une piteuse catastrophe, subitement trébucher celui qui naguères semblait être élevé jusqu'au haut plus degré d'honneur".
La catastrophe tragique selon les traducteurs de la Poétique d’Aristote
Pour comprendre le sens ancien, en français, de ‘catastrophe’, un sens qui perdure jusqu’au XIXe siècle, il nous faut remonter à un texte de l’Antiquité grecque, la Poétique d’Aristote. C’est, dans la tradition européenne, le texte fondateur sur l’art de composer les œuvres littéraires, la tragédie et l’épopée plus précisément. La poésie lyrique n’y figure pas et de la partie consacrée à la comédie, aujourd’hui perdue, Umberto Eco a tiré son célèbre roman, Le nom de la rose (1980).

Dans son traité, Aristote distingue et définit les différentes parties du poème tragique. Il y traite également des différentes manières de le composer et les évalue. Ses idées en la matière ont exercé une influence considérable. Mais le texte original de la Poétique ne comprend pas le terme ‘catastrophe’, qui appartient pourtant à la langue grecque. De quoi donc est-il alors la traduction ?
Vous l’apprendrez dans la deuxième partie de ce billet.