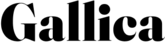L'Opéra au XVIIIe siècle : portraits d'artistes
Au XVIIIe siècle, les portraits des artistes de l'Opéra sont en plein essor ; ils assurent la renommée des artistes et renforcent leur visibilité. Individuels ou en groupe, privés ou publics, réalistes ou idéalisés, que nous disent ces portraits des acteurs du chant et de la danse à cette époque ?
Peints, gravés ou sculptés, les portraits des chanteurs et danseurs de l’Opéra de Paris se multiplient tout au long du XVIIIe siècle. Ce phénomène, qui renforce la visibilité des artistes dans l’espace public, constitue un indicateur de notoriété : le grand artiste n’est pas seulement celui dont on connaît le nom, mais celui dont on peut aussi identifier le visage. Comment étaient alors représentés les artistes de la scène lyrique et chorégraphique au XVIIIe siècle et comment retrouver leur trace dans les collections de la Bibliothèque-musée de l’Opéra (BMO) ?
Les maquettes et costumes : vrais ou faux portraits ?
La BMO conserve quelque huit-cents maquettes de costumes de Louis-René Boquet, « dessinateur des habits de l’Opéra » du milieu des années 1750 jusqu’en 1790. Aucun des rôles traditionnels n’échappa à sa plume ou à son pinceau : rois, princesses, démons, magiciennes, faunes, bacchantes, bergers, chasseresses, matelots, etc., tous ces personnages sont croqués dans leur somptueux costume de scène.
Souvent, lorsque l’effigie d’un artiste manque, il est parfois tentant de regarder ces maquettes comme des portraits d’acteurs, faute de mieux. Pourtant, deux autres raisons doivent nous en empêcher. Dans la plupart des cas, le portrait est le résultat d’un accord passé entre un peintre et son commanditaire : les deux parties s’entendent sur la pose à adopter, le type de représentation (portrait mythologique, portrait privé, portrait dans un rôle déterminé), le format et le support le plus adapté (toile, papier verger ou parchemin), puis conviennent d’un tarif. Ce n’est pas le cas des maquettes de costumes qui ne répondent à aucune transaction marchande entre le peintre et son modèle. Préparant le spectacle annoncé, elles sont soumises uniquement à l’appréciation du directeur de l’Opéra qui les rejette ou en accepte l’exécution. Par ailleurs, si le dessinateur des costumes de l’Opéra est bien recruté par l’institution en sa qualité de peintre, il n’est absolument pas reconnu comme un portraitiste de métier et ne bénéficie donc pas de la même estime de la part du public.
Parmi les nombreuses « scènes estampes » conservées à la BMO, une dernière doit retenir notre attention. C’est celle de Jean-Baptiste Tilliard, exécutée d’après un dessin de Carmontelle, représentant Marie Allard et son partenaire Dauberval dans le pas de deux de Sylvie, ballet héroïque en trois actes de Trial et Berton, créé en 1766. Si Carmontelle est bien connu pour avoir peint toute la société de son temps et réalisé le portrait de près d’un millier d’hommes et de femmes de toutes conditions, le dessin conservé au Museum of Fine Arts de Boston se distingue de l’ensemble de sa production : les deux modèles ne sont pas représentés de façon statique, figés dans un intérieur domestique, mais en pleine action chorégraphique. De ce portrait en mouvement, se dégage une merveilleuse impression de vie. Par ailleurs, les critiques visant Carmontelle disaient qu’il s’attachait parfois plus au vêtement qu’à la ressemblance du modèle. On ne saurait ici leur donner tort, tant le dessin et la gravure reproduisent jusqu’au plus insigne détail les motifs du costume de scène imaginé par Boquet en 1766.
Les tableaux peints
Comme le résume Antoine Lilti, le XVIIIe siècle est ce moment clé où se négocie, pour bon nombre d’artistes, le passage de la réputation (acquise localement) à la célébrité (reconnue mondialement). Nul doute que le portrait d’artiste participe de cette dynamique.
Repères bibliographiques :
Les maquettes et costumes : vrais ou faux portraits ?
La BMO conserve quelque huit-cents maquettes de costumes de Louis-René Boquet, « dessinateur des habits de l’Opéra » du milieu des années 1750 jusqu’en 1790. Aucun des rôles traditionnels n’échappa à sa plume ou à son pinceau : rois, princesses, démons, magiciennes, faunes, bacchantes, bergers, chasseresses, matelots, etc., tous ces personnages sont croqués dans leur somptueux costume de scène.
Souvent, lorsque l’effigie d’un artiste manque, il est parfois tentant de regarder ces maquettes comme des portraits d’acteurs, faute de mieux. Pourtant, deux autres raisons doivent nous en empêcher. Dans la plupart des cas, le portrait est le résultat d’un accord passé entre un peintre et son commanditaire : les deux parties s’entendent sur la pose à adopter, le type de représentation (portrait mythologique, portrait privé, portrait dans un rôle déterminé), le format et le support le plus adapté (toile, papier verger ou parchemin), puis conviennent d’un tarif. Ce n’est pas le cas des maquettes de costumes qui ne répondent à aucune transaction marchande entre le peintre et son modèle. Préparant le spectacle annoncé, elles sont soumises uniquement à l’appréciation du directeur de l’Opéra qui les rejette ou en accepte l’exécution. Par ailleurs, si le dessinateur des costumes de l’Opéra est bien recruté par l’institution en sa qualité de peintre, il n’est absolument pas reconnu comme un portraitiste de métier et ne bénéficie donc pas de la même estime de la part du public.
Parmi les nombreuses « scènes estampes » conservées à la BMO, une dernière doit retenir notre attention. C’est celle de Jean-Baptiste Tilliard, exécutée d’après un dessin de Carmontelle, représentant Marie Allard et son partenaire Dauberval dans le pas de deux de Sylvie, ballet héroïque en trois actes de Trial et Berton, créé en 1766. Si Carmontelle est bien connu pour avoir peint toute la société de son temps et réalisé le portrait de près d’un millier d’hommes et de femmes de toutes conditions, le dessin conservé au Museum of Fine Arts de Boston se distingue de l’ensemble de sa production : les deux modèles ne sont pas représentés de façon statique, figés dans un intérieur domestique, mais en pleine action chorégraphique. De ce portrait en mouvement, se dégage une merveilleuse impression de vie. Par ailleurs, les critiques visant Carmontelle disaient qu’il s’attachait parfois plus au vêtement qu’à la ressemblance du modèle. On ne saurait ici leur donner tort, tant le dessin et la gravure reproduisent jusqu’au plus insigne détail les motifs du costume de scène imaginé par Boquet en 1766.
François-Rolland Elluin, d’après Pierre-Thomas Le Clerc, Rosalie Duplant de l’Académie roiale de musique…, 1771
Seuls les très grands artistes, bénéficiant d’une renommée dépassant le cercle de leur profession, pouvaient se payer le luxe de se faire représenter par les portraitistes les plus recherchés. Ce fut le cas de Marie Sallé et de Marie Fel, leurs portraits réalisés par Maurice Quentin Delatour furent respectivement présentés aux Salons de 1741 et 1757. Tout au long de sa brillante carrière, Jélyotte eut les honneurs d’Antoine Coypel, Louis Tocqué, Carle Vanloo ou Alexandre Roslin : ces portraits sont conservés au Louvre, à l’Ermitage et au musée de l’Opéra. Le chorégraphe Jean-Georges Noverre, quant à lui, se fit portraiturer en 1764 par Jean-Baptiste Perronneau, de passage à Stuttgart. Au dos du pastel conservé à la BMO, on peut lire une inscription autographe qui révèle le « partage de notoriété » qui pouvait s’établir entre un peintre et son modèle : « M.r Novert d’origine Suisse. restaurateur de la danse des anciens. Celebre pour ses balets. pein par J.B. Perronneau de lacademy Royalle de peinture. » Pour un artiste du chant ou de la danse, avoir son effigie peinte par quelqu’un d’aussi « célèbre » que lui dans son domaine était une forme de consécration qui pouvait servir le désir de reconnaissance sociale de l’artiste. Pour peu que le peintre fût académicien, il avait la possibilité d’exposer son portrait au Salon du Louvre, qui recueillait, selon les années, entre 10 000 et 30 000 visiteurs. Admiré ou rejeté, le portrait était alors transformé en objet de critique par les hommes de lettres – on pense aux Salons de Diderot ou aux Mémoires secrets de Bachaumont – et pouvait potentiellement fonctionner comme un instrument d’accélération de la carrière de l’artiste.
Portrait de Jean-Georges Noverre, par Jean-Baptiste Perronneau, pastel sur papier, 1764
Comme le résume Antoine Lilti, le XVIIIe siècle est ce moment clé où se négocie, pour bon nombre d’artistes, le passage de la réputation (acquise localement) à la célébrité (reconnue mondialement). Nul doute que le portrait d’artiste participe de cette dynamique.
Repères bibliographiques :
- Aliverti (Maria Inès), La Naissance de l’acteur moderne. L’acteur et son portrait au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998.
- Arnoult (Dominique d’), Jean-Baptiste Perronneau, ca 1715-1783. Un portraitiste dans l’Europe des Lumières, Paris, Arthéna, 2015.
- Ichou (Grégoire), Les Portraits des chanteuses des théâtres privilégiés parisiens dans le troisième quart du XVIIIe siècle, Mémoire de Master 1, Université de Paris I, 2016.
- Lallement (Nicole), « Iconographie d’un chanteur XVIIIe au siècle : Pierre Jélyotte (1713-1797) », Musique-Image-Instruments. Iconographie musicale : enjeux, méthodes et résultats, n°10, 2008, p. 108-119.
- Lilti (Antoine), Figures publiques. L’invention de la célébrité, 1750-1850, Paris, Fayard, 2014.