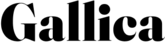Un philosophe féministe : John Stuart Mill (1806-1873)
Dans l’Angleterre victorienne, un philosophe s’engage dans la lutte pour les droits des femmes.
En 1869, le philosophe libéral et représentant de l’utilitarisme John Stuart Mill publie à Londres The Subjection of Women. L’ouvrage est traduit en français la même année puis de nouveau en 1876 sous le titre de L’assujettissement des femmes.
Aux yeux de Mill, l’assujettissement des femmes, c’est-à-dire leur dépendance absolue au point de vue juridique (notamment dans l’institution du mariage), économique et social, est non seulement injuste et scandaleux pour « une moitié du genre humain », mais son abolition serait « un gain prodigieux » pour toute l’humanité. Mill voit en effet dans cette injustice la racine même du mal social : « Tous les penchants égoïstes, le culte de soi-même, l’injuste préférence de soi-même, qui dominent dans l’humanité, ont leur source et leur racine dans la constitution actuelle des rapports de l’homme et de la femme, et y puisent leur principale force » (L'assujetissement des femmes, p. 195). Il milite donc pour une « égalité parfaite, sans privilège ni pouvoir pour un sexe, comme sans incapacité pour l’autre » (Ibid., p. 2).
John Stuart Mill s’est engagé politiquement pour cette égalité des sexes avant même la rédaction de The Subjection of Women. En 1866, Mill, alors parlementaire, déposa au Parlement une pétition pour le droit de vote des femmes qui fut rejetée. Cette pétition avait été lancée par les suffragistes Emily Davies (1830-1921) et Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917). Cette dernière fut la première docteure de la Faculté de médecine de Paris en 1870. Elle avait dû poursuivre ses études de médecine en France car son inscription avait été refusée par les universités britanniques.
« Les progrès de mon esprit dont je fus redevable à ma femme ne sont point, il s'en faut bien, ceux que pourraient croire des personnes mal informées sur ce point. On pourrait supposer, par exemple, que la forte conviction que j'ai exprimée en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les rapports légaux, politiques, sociaux et domestiques, je la tiens d'elle. Il n'en est rien. Au contraire cette conviction fut l'un des premiers résultats auxquels j'arrivai en étudiant les questions politiques, et la force avec laquelle je la défendais fut, plus que toute autre raison, la cause première de l'intérêt qu'elle se sentit pour moi (…) Mais ce ne fut que grâce à ses leçons que je compris l’immense portée des résultats réels de l'incapacité des femmes, telle que je l'ai exposée dans mon livre de L’Assujettissement des Femmes. Sans le secours de la rare connaissance qu'elle possédait de la nature humaine, et de la pénétration avec laquelle elle saisissait les effets des influences morales et sociales, j'aurais sans doute toujours professé les opinions que j'ai aujourd'hui, mais je n'aurais eu qu'une idée imparfaite de la manière dont les conséquences de la situation d'infériorité des femmes viennent s'entremêler avec les maux de la société existante et avec les difficultés qui arrêtent le progrès humain. Aussi est-ce avec un sentiment douloureux que je songe à toutes les idées excellentes qu'elle émettait sur ce sujet, et que je n'ai pas réussi à reproduire, et que je mesure la distance énorme qui sépare mon petit traité de ce qu'il aurait été si elle avait mis sur la papier tout ce qu'elle avait dans l'esprit sur cette question, ou si elle avait assez vécu pour revoir et améliorer, ce qu'elle n'eût pas manqué de faire, l'exposé imparfait que j'en ai donné ». (Mes Mémoires, p. 233-234).
Pour aller plus loin
La page "Gallica vous conseille" consacrée au féminisme propose de nombreux ouvrages sur ce sujet, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges à L'Emancipation de la femme ou Le Testament de la paria de Flora Tristan, en passant par Le Vote des femmes d'Hubertine Auclert.