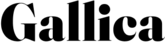Classiques européens pour la jeunesse : l'art du partage (1)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Gallica revient sur la circulation des textes en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles, au cours desquels s’est constitué un corpus européen de classiques de la littérature pour la jeunesse. Partons sur les traces de Robinson, Pierre l’ébouriffé, Heidi et Alice…
C’est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que s’invente, dans les riches pays de l’Europe du nord, une fiction spécifiquement destinée à l’enfance et à la jeunesse. La traduction devient immédiatement partir prenante de cette jeune littérature. Les premiers écrivains pour enfants s’imitent, se traduisent et s’entre-traduisent.
Arnaud Berquin (1747-1791), homme de lettres, précepteur et traducteur, se spécialise dans les écrits pour la jeunesse. C’est avec les 24 numéros de L’Ami des enfans, publiés de 1782 à 1783, qu’il passe à la postérité, inaugurant en France les publications en livraisons périodiques destinées à la jeunesse. Il y propose des petites historiettes morales, contes et drames ancrés dans le quotidien de l’enfant. Il emprunte ce titre et plusieurs historiettes à l’allemand Christian Félix Weisse (Kinderfreund, 1772). Nombre de ses écrits sont inspirés des littératures allemande, anglaise et néerlandaise : il a contribué à l’ouverture de la France aux littératures étrangères contemporaines. En décembre 1783, il renouvelle sa reconnaissance « à MM. Weisse, Campe, Salzmann et Schummel, pour les bons matériaux et les bons modèles qu’il a trouvés dans leurs ouvrages ». Il explique sa démarche d’appropriation : « soit en les accommodant à notre gout, à nos usages et à nos mœurs, soit en y ajoutant des idées et des peintures nouvelles, soit enfin pour le style et le ton qui lui appartiennent ». A son tour, la publication est diffusée et traduite dans toute l’Europe. Pendant près d’un siècle, les frontières sont poreuses entre « imitation », « traduction libre » et « traduction », comme si l’invention fictionnelle était un vaste bien commun dans lequel chacun pouvait venir puiser, à charge pour lui de rendre sa réappropriation attrayante et conforme aux attentes de son nouveau public. La circulation des œuvres par la traduction a contribué de manière décisive à construire et renouveler les grands genres de la littérature de jeunesse.
Les Contes de Christophe Schmid (1768-1854), dit le chanoine Schmid, ont connu une fortune considérable dans toute l’Europe, et particulièrement en France à partir des années 1820. Il fut l’un des écrivains pour enfants les plus lus, les plus traduits, les plus diffusés en Europe tout au long du XIXe siècle. Les œufs de Pâques et Geneviève de Brabant figurent parmi les textes les plus publiés du siècle. Au fil des traductions, rééditions, adaptations et imitations, le nom de Schmid fonctionne comme une « marque de fabrique ». Le catholicisme de l’auteur apporte une caution morale recherchée par les éditeurs catholiques : quand la maison Mame crée la collection « La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne » en 1836, les récits et historiettes morales de Schmid (traduits par Louis Friedel) en constituent le socle principal.
Arnaud Berquin (1747-1791), homme de lettres, précepteur et traducteur, se spécialise dans les écrits pour la jeunesse. C’est avec les 24 numéros de L’Ami des enfans, publiés de 1782 à 1783, qu’il passe à la postérité, inaugurant en France les publications en livraisons périodiques destinées à la jeunesse. Il y propose des petites historiettes morales, contes et drames ancrés dans le quotidien de l’enfant. Il emprunte ce titre et plusieurs historiettes à l’allemand Christian Félix Weisse (Kinderfreund, 1772). Nombre de ses écrits sont inspirés des littératures allemande, anglaise et néerlandaise : il a contribué à l’ouverture de la France aux littératures étrangères contemporaines. En décembre 1783, il renouvelle sa reconnaissance « à MM. Weisse, Campe, Salzmann et Schummel, pour les bons matériaux et les bons modèles qu’il a trouvés dans leurs ouvrages ». Il explique sa démarche d’appropriation : « soit en les accommodant à notre gout, à nos usages et à nos mœurs, soit en y ajoutant des idées et des peintures nouvelles, soit enfin pour le style et le ton qui lui appartiennent ». A son tour, la publication est diffusée et traduite dans toute l’Europe. Pendant près d’un siècle, les frontières sont poreuses entre « imitation », « traduction libre » et « traduction », comme si l’invention fictionnelle était un vaste bien commun dans lequel chacun pouvait venir puiser, à charge pour lui de rendre sa réappropriation attrayante et conforme aux attentes de son nouveau public. La circulation des œuvres par la traduction a contribué de manière décisive à construire et renouveler les grands genres de la littérature de jeunesse.
En ce qui concerne les contes et historiettes morales, l’influence germanique est forte dans la première moitié du XIXe siècle.Plusieurs fois j'ai lu cette historiette à des auditeurs de différents âges, et j'ai eu lieu de faire la remarque qu'elle était écoutée avec un vif intérêt, non seulement par les enfants, mais même par des personnes d'un âge mûr. Les oeufs de Pâques.
Les Contes de Christophe Schmid (1768-1854), dit le chanoine Schmid, ont connu une fortune considérable dans toute l’Europe, et particulièrement en France à partir des années 1820. Il fut l’un des écrivains pour enfants les plus lus, les plus traduits, les plus diffusés en Europe tout au long du XIXe siècle. Les œufs de Pâques et Geneviève de Brabant figurent parmi les textes les plus publiés du siècle. Au fil des traductions, rééditions, adaptations et imitations, le nom de Schmid fonctionne comme une « marque de fabrique ». Le catholicisme de l’auteur apporte une caution morale recherchée par les éditeurs catholiques : quand la maison Mame crée la collection « La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne » en 1836, les récits et historiettes morales de Schmid (traduits par Louis Friedel) en constituent le socle principal.