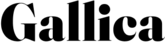Entre le 9 et le 17 novembre 1938, Colette est envoyée à Fez avec Maurice Goudeket, son troisième mari, par Paris-Soir afin de rendre compte du procès de « Moulay Hassen », pseudonyme d’Oum-El-Hassen, accusée d’assassinat de prostituées. L’affaire lui inspire trois articles successifs. « L’incroyable procès de Moulay Hassen » (15 novembre 1938), « Couverte de mousseline blanche, parée de ses bijoux, Moulay Hassen reste impassible devant ses juges » (16 novembre), enfin, « Après une seconde journée dramatique Oum El Hassen est condamnée à quinze ans de travaux forcés et son complice Mohammed Ben Ali à dix ans de la même peine » (17 novembre). Elle publie ce reportage revu et augmenté dans Journal à rebours en 1941.
Quel est le propos de Colette dans ces articles ?
A Meknès, des restes humains ont été trouvés à proximité de la maison de « Moulay Hassen », rapidement suspectée. L’accusée n’a pas à son actif qu’une carrière de prostituée. Elle « n’était pas une chèvre du banal troupeau. Ses yeux d’un vert brûlant, inoubliables, révélaient-ils la trace d’un sang occidental ? ». Elle semble ne se plaire qu’avec les officiers français, auxquels elle ouvre une maison accueillante. « C’est au péril de sa propre vie qu’elle cache chez elle et sauve une précieuse poignée d’officiers menacée par les révoltes de 1912 et de 1925 », de sorte que plusieurs d’entre eux demandent pour elle la légion d’honneur. Aujourd’hui, elle a perdu sa beauté, et tous lui tournent le dos.
Le complice, Mohammed Ben Ali est passé aux aveux. Pour Colette, il « est bien la plus noire figure du procès ». En comparaison, avec l’accusée « nous semblons réintégrer une conception plus humaine de la criminalité ». Colette reconnaît pourtant toute l’horreur des crimes. La présence, à l’audience, des instruments utilisés pour les perpétrer, la rend évidente : la marmite dans laquelle le corps a été bouilli, la corde des étrangleurs, le grand couteau, le hachoir, le couffin dans lequel a été retrouvée la dépouille. Outre ce meurtre, la perquisition dans la maison a permis de délivrer quatre jeunes filles et un garçon qui s’y trouvaient emmurés et, parmi les prostituées qui y étaient employées, plusieurs sont mortes ou ont disparu.
Colette accorde cependant à l’accusée des circonstances atténuantes : Comment pourrait-elle comprendre qu’elle fait preuve de cruauté avec ses « employés », alors que « ce que nous appelons cruauté fut l’ordinaire, la sanglante et joyeuse monnaie courante de sa vie depuis l’enfance » ? Quant aux victimes, Colette ne montre pas beaucoup de compassion à l’égard de ce « doux bétail, mais bétail dont l’inattaquable, l’écrasante stupidité écoeure » !
Le procès d’Eugène Weidmann
Toujours pour Paris-Soir, Colette suit, du 11 mars au 2 avril 1939, les audiences du procès de Weidmann, tueur condamné à mort par la cour d’assises de Versailles. Elle avait déjà publié ses réflexions consécutives à l’arrestation du tueur, en décembre 1937, sous le titre « Assassins » (Le Journal, 19 décembre 1937). Elle y comparait Weidmann au criminel anglais Patrick Mahon, tous deux ayant belle prestance et partageant un goût pour la nature, et s’interroge : « Est-il sain d’esprit le garçon aux longs cils qui soignait ses rosiers […] ? Ou bien est-il sadique, porteur d’un invisible cilice qui le brûle de félicité ? [...] Trop tôt apparié aux monstres légendaires, il n’est déjà plus qu’un entrepreneur de disparitions, qui n’a pas réussi, et qui est bien embêté.»
A l’occasion du procès de Weidmann et de ses complices, Colette se montre prolifique. Elle écrit « Le monstre » (Paris-Soir, 11 mars 1939), où elle se demande si Weidmann va paraître diminué, à l’audience, par quinze mois de détention. Le Weidmann « D’une voix insaisissable, ce jeune homme se charge d’une longue liste de crimes » (12 mars) semble accablé de sommeil, mais est dépourvu, elle le constate, du « sceau physique d’une déchéance, d’une férocité ». Elle est plus sévère avec ses complices, « Jean Blanc, coloré, à la dégaine d’un fils de famille un peu provincial. Million est un rongeur effrayé […] Petit gibier… Petit gibier aussi, Mlle Tricot, un peu joufflue maintenant, et si remarquablement inexpressive… ». « « Encore 18 jours ! » a soupiré Eugène Weidmann » (13 mars) présente un accusé passif, quand, dans « Enfin Weidmann s’est éveillé » (15 mars), il fait preuve d'un sursaut de combativité. Dans « La véritable évasion de Weidmann » (19 mars), il endosse la culpabilité des crimes à l’exception de celui de Roger Leblond qu’il impute à Million. « Après le verdict : le dernier jour, Weidmann a souri à la mort » (2 avril), conclut Colette. Elle y qualifie le condamné de « criminel horrible » :
Que devons-nous appeler un criminel horrible ? Celui qui nous remplit d’effroi, non pour ce qu’il nous présente de bestial et de grossièrement terrifique, mais pour ce qui le rapproche de nous […]. Quoi, ce « monstre » qui a sauté la barrière […] était hier notre semblable ?
Le 17 juin suivant, Weidmann est le
dernier guillotiné en place publique. Une bousculade a lieu ce jour-là à l’entrée de la prison de Versailles. Édouard Daladier promulgue, par la suite, un
décret supprimant la publicité des exécutions capitales, qui se dérouleront dès lors dans l’enceinte des prisons.
Le traitement colettien des affaires criminelles
Dans Mes Cahiers, Colette rapporte en outre, dans un chapitre intitulé « Monstres », le procès de Marie Becker, reconnue coupable et condamnée à mort, le 8 juillet 1938, à Liège, de onze meurtres et de cinq tentatives de meurtre ; ainsi que l’affaire Stavisky, scandale judiciaire, politique et financier. Dans toutes ces affaires, parallèlement aux comptes rendus des audiences établis par d’autres journalistes, ce sont ses « impressions d’audiences » que Colette livre aux lecteurs. Les organes de presse pour lesquels elle écrit l’annoncent parfois clairement, comme c’est le cas de Paris-Soir qui répartit les rôles entre Colette et son collègue Robert François, à l’occasion de l’affaire Weidmann.
Pour Gérard Bonal et Frédéric Maget, dès l’article qu’elle consacre à l’arrestation de Bonnot, en 1912, « Colette affirme son originalité, une façon de percevoir et de retranscrire l’événement qui n’appartient qu’à elle : elle ne parle que de ce qu’elle connaît […] et ne raconte que ce qu’elle a vu. » Ils rapportent les principes que suit l’écrivaine selon lesquels « il faut voir et non inventer, […] palper et non imaginer », ainsi que les propos élogieux de Germaine Beaumont à l’égard des impressions d’audiences de Colette, dont elle explique la qualité par « sa merveilleuse aptitude à saisir, chez un être humain, ce qui échappait à d’autres observateurs. »
Selon Amélie Chabrier, le traitement de Colette, qu’elle définit comme une « chronique d’allure judiciaire » reprenant l’expression de Josette Rico, se distingue par un décalage « poétique, éthique et stylistique ».
Les employeurs de Colette profitent de sa notoriété et mettent son nom en avant pour attirer les lecteurs. C’est le cas de
L’Intransigeant, qui annonce le
10 octobre 1934, « le procès de Violette Nozière vu jeudi… par Colette ».
Paris-Soir, « où brillent les signatures les plus éclatantes de notre temps », à son tour, fait savoir à ses lecteurs qu’il va publier un roman inédit de Colette, « notre grande romancière » (
16 juin 1938), et attire l’attention sur l’identité de son
envoyée spéciale au procès Moulay-Hassen à Fez, en novembre 1938, avec photographie de Colette à l’appui.
Certaines des chroniques de Colette seront rééditées, parfois après réécriture, dans Dans la foule, Contes des mille et un matins, Prisons et paradis, puis dans Journal à rebours, preuve que Colette était poursuivie par « ses monstres » ?...
Pour aller plus loin :